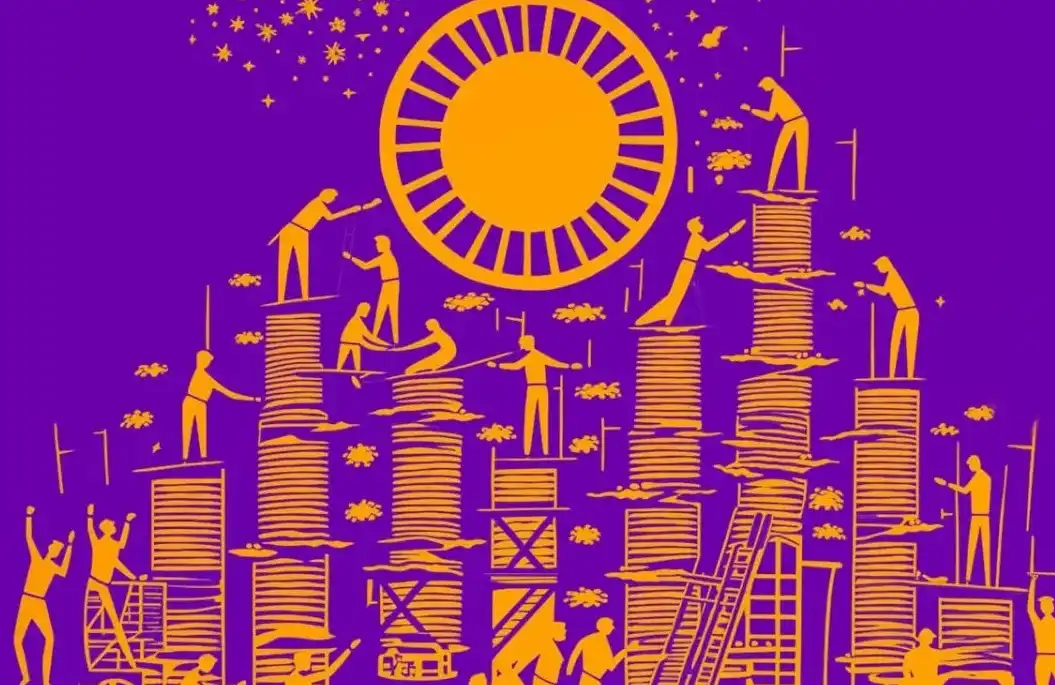Combien de frais de service une plateforme Web3 devrait-elle facturer ?
Les frais ne sont pas simplement un outil de prélèvement, ils peuvent également constituer un mécanisme de collaboration.
Les frais ne sont pas simplement un outil de prélèvement, ils peuvent également constituer un mécanisme de coordination.
Auteurs : Gérard Cachon, Tolga Dizdarer, Gerry Tsoukalas
Traduction : Luffy, Foresight News
Web3 vise à réduire la dépendance aux intermédiaires afin de diminuer les frais de service et de donner aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs données et leurs actifs. Par exemple, Gensyn (plateforme décentralisée de puissance de calcul pour l’IA) propose des services de calcul d’intelligence artificielle à une fraction du prix d’Amazon Web Services (AWS) ; Drife (plateforme de mobilité décentralisée) promet d’aider les chauffeurs à échapper à la commission pouvant atteindre 30% imposée par Uber.
Cependant, bien que l’idée de réduire les coûts pour les utilisateurs soit séduisante, l’établissement de normes de frais et de tarification raisonnables exige que la plateforme trouve un équilibre entre les intérêts de toutes les parties. Les marchés décentralisés les plus performants ne renoncent pas totalement aux frais, mais combinent une « tarification décentralisée » avec une structure de frais soigneusement réfléchie et génératrice de valeur ajoutée, afin d’atteindre un équilibre entre l’offre et la demande.
Sur la base de nos recherches, cet article expliquera : le rôle du contrôle des prix et de la structure des frais dans l’économie des plateformes et leur gouvernance ; pourquoi le modèle « zéro frais », aussi bien intentionné soit-il, est voué à l’échec ; et comment les plateformes blockchain devraient élaborer leurs stratégies de tarification. Nous proposons un nouveau modèle de « tarification affine » basé sur le volume de transactions, qui permet de résoudre la contradiction entre information privée et coordination du marché.
Pourquoi la tarification et les frais sont-ils importants
La prospérité ou le déclin des plateformes numériques dépend de leur capacité à gérer deux leviers fondamentaux : le contrôle des prix et la structure des frais (c’est-à-dire le montant facturé aux acheteurs et vendeurs utilisant leurs services). Ces deux éléments ne sont pas seulement des outils de génération de revenus, mais aussi des instruments de conception de marché qui façonnent le comportement des utilisateurs et déterminent les résultats du marché.
Le contrôle des prix détermine « qui fixe le prix des transactions ». Par exemple, Uber fixe les tarifs via un algorithme centralisé pour optimiser l’équilibre entre l’offre et la demande et la stabilité des prix ; à l’inverse, Airbnb donne aux hôtes le pouvoir de fixer librement leurs prix, en les guidant modérément par des suggestions algorithmiques. Chaque modèle a ses priorités : la tarification centralisée assure l’efficacité de la coordination dans les marchés de grande taille ; la tarification décentralisée permet aux fournisseurs de services d’intégrer des informations privées (telles que les coûts, la qualité du service, les avantages différenciés, etc.) dans leur stratégie de prix. Il n’y a pas de supériorité absolue entre les deux modèles, leur efficacité dépend du contexte d’application.
L’impact de la structure des frais ne se limite pas aux revenus de la plateforme, il détermine également quels participants entreront sur le marché et comment ce marché fonctionnera. L’App Store d’Apple prélève une commission pouvant atteindre 30%, utilisée à la fois pour sélectionner des applications de qualité, financer l’infrastructure de la plateforme, mais pouvant aussi susciter le mécontentement des développeurs d’applications, sans affecter directement les utilisateurs ; à l’inverse, les frais élevés de Ticketmaster incitent artistes et fans à se tourner vers d’autres canaux lorsqu’il existe des alternatives. Du côté des frais faibles, la gratuité de la mise en ligne sur Facebook Marketplace a engendré des problèmes d’escroquerie ; plusieurs plateformes NFT à frais quasi nuls ont vu affluer des NFT de faible qualité, perturbant l’expérience utilisateur.
La règle est claire : des frais trop élevés font fuir les fournisseurs ; des frais trop bas nuisent à la qualité des services/produits.
De nombreux projets blockchain adoptent un modèle de commission zéro, partant du principe que renoncer à la capacité d’extraire de la valeur permet d’obtenir de meilleurs résultats pour les fournisseurs et les utilisateurs. Mais cette vision néglige le rôle clé des « frais raisonnablement conçus » dans le bon fonctionnement du marché : les frais ne sont pas simplement un outil de prélèvement, ils peuvent également constituer un mécanisme de coordination.
L’arbitrage entre information et coordination
Le dilemme central de la conception des plateformes est le suivant : comment trouver un équilibre entre « exploiter l’information privée des fournisseurs de services » et « coordonner le marché pour améliorer l’efficacité ». Nos recherches montrent que la manière dont le contrôle des prix et la structure des frais interagissent détermine si ce dilemme est résolu ou aggravé.
Lorsque la plateforme fixe directement les prix, elle peut plus facilement coordonner l’offre et la concurrence entre fournisseurs, mais, faute de connaître le coût privé de chaque fournisseur (coûts d’exploitation, coûts marginaux, etc.), la tarification entraîne souvent un désalignement entre l’offre et la demande : le prix est trop élevé pour certains utilisateurs, trop bas pour certains fournisseurs. La plateforme prélève généralement une commission sur le montant des transactions, mais cette tarification inefficace finit par entraîner une perte de profits.
Si les fournisseurs de services fixent eux-mêmes leurs prix, en théorie, ceux-ci reflètent leurs coûts réels et leur capacité de service : les fournisseurs à faible coût peuvent baisser leurs prix pour obtenir un avantage concurrentiel, ce qui permet une meilleure adéquation entre l’offre et la demande et une plus grande efficacité du marché. Mais un modèle de tarification sans coordination peut avoir l’effet inverse sur deux plans.
Lorsque les produits ou services sont fortement homogénéisés, cela peut déclencher une guerre des prix. Les fournisseurs à coûts élevés sont contraints de quitter le marché, réduisant ainsi l’offre ; or, la demande est souvent en hausse à ce moment-là, ce qui finit par affaiblir la capacité de la plateforme à répondre à la demande du marché. Par ailleurs, la baisse du prix moyen peut profiter aux consommateurs, mais elle impacte directement le modèle de revenus basé sur la commission de la plateforme.
Lorsque les produits ou services doivent être combinés pour offrir une valeur maximale, les fournisseurs ont tendance à fixer des prix trop élevés. Bien que de nombreux fournisseurs affluent sur la plateforme, les prix élevés qu’ils fixent font grimper le prix moyen du marché, ce qui finit par faire fuir les utilisateurs.
Ce n’est pas une simple spéculation théorique : en 2020, Uber a testé le « programme Luigi » en Californie, permettant aux chauffeurs de fixer eux-mêmes leurs tarifs. Les résultats ont montré que les tarifs fixés par les chauffeurs étaient généralement trop élevés, poussant les utilisateurs vers d’autres plateformes de mobilité, et le programme a été abandonné après environ un an.
Conclusion clé : ces résultats ne sont pas accidentels, mais constituent l’équilibre sous un contrat de commission standard ; même en optimisant le contrat de commission, de telles défaillances de marché persistantes peuvent survenir. Ainsi, la question centrale n’est pas « combien de commission la plateforme doit-elle prélever », mais « comment concevoir une structure de frais qui assure l’efficacité du marché pour tous les participants ».
Comment résoudre le problème
Nos recherches montrent qu’une structure de frais ciblée peut habilement résoudre le problème de coordination du marché tout en conservant les avantages de la « personnalisation des prix ». Ce modèle de frais affine adopte un mécanisme de « tarification en deux parties », où les fournisseurs de services doivent verser à la plateforme :
- Des frais fixes de base par transaction ;
- Des frais variables : qui augmentent avec le volume de transactions (supplément), ou diminuent avec le volume de transactions (remise).
Ce modèle a des effets différenciés selon le coût et le positionnement de chaque fournisseur sur le marché.
Dans ces marchés, les coûts des fournisseurs varient considérablement : certains fournisseurs, grâce à des technologies avancées, à l’accès à l’énergie renouvelable ou à des systèmes de refroidissement efficaces, ont des coûts naturellement plus bas ; d’autres, bien que plus coûteux, peuvent offrir des services premium à haute fiabilité.
Dans le modèle de commission traditionnel, si la concurrence est excessive, les fournisseurs de GPU à faible coût fixent des prix très agressifs, accaparant une part de marché trop importante, ce qui entraîne les distorsions de marché mentionnées précédemment : certains fournisseurs quittent le marché, limitant le volume des transactions, tandis que le prix moyen du marché baisse.
Pour ce scénario, la stratégie optimale est le « supplément sur le volume de transactions » : plus un fournisseur a de clients, plus il paie de frais par transaction.
Ce mécanisme impose une « contrainte naturelle » aux fournisseurs à faible coût les plus agressifs, les empêchant de s’accaparer une part de marché excessive par des prix insoutenables, et préservant ainsi l’équilibre du marché.
Lorsque la concurrence sur le marché est modérée ou insuffisante, la stratégie optimale devient la « remise sur le volume de transactions » : plus un fournisseur a de clients, moins il paie de frais par transaction. Ce mécanisme incite les fournisseurs à baisser leurs prix pour augmenter leur volume de transactions, améliorant ainsi la compétitivité du marché sans que les prix ne tombent sous un seuil soutenable.
Par exemple, sur une plateforme sociale décentralisée, il est possible de facturer des frais plus bas aux « créateurs ayant un volume d’interactions plus élevé », les encourageant à fixer des prix plus compétitifs pour leurs contenus payants, tout en attirant plus d’utilisateurs.
L’élégance du mécanisme de frais affine réside dans le fait qu’il n’exige pas de la plateforme qu’elle connaisse le coût précis de chaque fournisseur ; la structure des frais crée des incitations positives, guidant les fournisseurs à s’auto-réguler en fonction de leurs coûts privés. Les fournisseurs à faible coût peuvent toujours obtenir un avantage en proposant des prix inférieurs à ceux de leurs concurrents à coût élevé, mais la structure des frais les empêche de monopoliser le marché au détriment de la santé de l’écosystème.
Nos simulations mathématiques confirment qu’une « structure de frais basée sur le volume de transactions » correctement calibrée permet à la plateforme d’atteindre plus de 99% de l’efficacité théorique optimale du marché. Dans le cadre théorique, elle surpasse largement les modèles de « tarification centralisée » et de « commission zéro ». Le marché qui en résulte présente les caractéristiques suivantes :
- Les fournisseurs à faible coût conservent un avantage concurrentiel sans accaparer une part de marché excessive ;
- Les fournisseurs à coût élevé peuvent continuer à participer en se concentrant sur des « segments de marché différenciés » ;
- Le marché dans son ensemble atteint un état d’équilibre plus équilibré, avec des différences de prix raisonnables ;
- La plateforme améliore la fonctionnalité du marché tout en assurant des revenus durables.
De plus, l’analyse montre que la structure de frais optimale dépend des « caractéristiques observables du marché », et non des « informations privées sur les coûts » de chaque fournisseur. Lors de la conception des contrats, la plateforme peut utiliser des signaux observables tels que le « prix » et le « volume de transactions » comme indicateurs indirects des « coûts cachés », permettant aux fournisseurs de conserver leur pouvoir de fixation des prix basé sur leurs informations privées, tout en résolvant les problèmes de coordination inhérents aux systèmes entièrement décentralisés.
Perspectives d’avenir pour les projets blockchain
De nombreux projets blockchain, en adoptant un modèle de commission traditionnel ou zéro frais, nuisent à leur propre viabilité financière et réduisent l’efficacité du marché.
Nos recherches confirment que la conception d’une structure de frais raisonnable n’est pas contraire à la décentralisation, mais constitue au contraire un élément clé pour construire un marché décentralisé fonctionnel.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
Vous pourriez également aimer
SwissBorg fait face à une violation de 41 millions de dollars en Solana liée à l'API Kiln
Le CTO de Ledger met en garde les détenteurs de portefeuilles après le piratage du compte NPM
OpenSea dévoile la phase finale des récompenses pré-TGE, avec les détails de l’allocation de $SEA attendus en octobre

IOSG : Pourquoi la saison des shitcoins à "acheter les yeux fermés" est-elle devenue de l'histoire ancienne ?
L’avenir du marché des altcoins pourrait évoluer vers une « barbellisation », avec d’un côté la domination des projets DeFi blue-chip et d’infrastructure, et de l’autre des altcoins hautement spéculatifs.